Dossier : Gautier et le paysage
Théophile Gautier et les peintres paysagistes
Un dossier constitué par Anne-Lise Duret
En 1655, les frères Goncourt affirment que « le paysage est la victoire de l’art moderne. Il est l’honneur de la peinture du XIXème siècle » (Jules et Edmond De Goncourt, La Peinture à l’exposition universelle de 1855, Paris, Dentu, 1855). Le triomphe de ce genre remonte à 1816, date à la quelle le paysage historique est reconnu comme genre à part entière par l’Académie et qu’un Prix de Rome lui est enfin consacré. Les décennies qui suivent voient alors cette peinture s’épanouir, se diversifier, jusqu’à devenir l’un des lieux majeurs des révolutions picturales qui ont marqué le XIXème siècle, de l’école du « Plein-Air », jusqu’à l’impressionnisme.
Rien de surprenant, donc, à ce que le paysage dans la critique d’art de Théophile Gautier occupe une place très importante. Au-delà des simples compte-rendus de Salons, Théophile Gautier va saisir l’œuvre des paysagistes pour développer nombre réflexions sur l’art et sur son évolution.
- I. Quelle place pour le paysage en peinture ?
Parmi les nombreux articles consacrés au paysage celui du 11 août 1849 peut retenir notre attention. En effet, l’exposition des œuvres de Camille Corot, Alphonse Teytaud ou encore Paul Flandrin au Salon sont pour Gautier l’occasion de développer sa réflexion sur l’origine et les raisons de l’intérêt nouveau des peintres pour la nature.
Le paysage est une chose d’invention moderne. Les anciens ne l’ont pas soupçonné. Le paganisme ne voyait dans les arbres que l’habitation des Hamadryades, […] dans le soleil qu’un dieu menant un quadrige d’or ; chaque objet était pour ainsi dire anthropomorphisé, transformation préalable pour l’élever à la dignité de l’art. Le christianisme a regardé la nature avec sa défiance pour tout ce qui est matière ; partout où le paganisme plaçait des dieux, lui plaçait des diables, la beauté lui semblait le masque de la tentation ; les magnificences de la terre avaient pour lui l’inconvénient de distraire du ciel ; il redoutait les fraîches Tempés, les beaux ombrages, les fleurs au parfum enivrant, les lacs qui invitent au bain, le chant des oiseaux les harmonies du soir, tout ce qui éveille des idées de vie universelle, d’amour et de liberté.
Avant l’époque où nous sommes, à part Poussin et Claude Lorrain, qui encore ont même beaucoup de fabriques à leurs paysages relevés par le style et la composition, il n’y a guère que Ruysdael qui réponde exactement à ce que nous entendons aujourd’hui par paysagiste : la reproduction pure et simple d’un vallon, d’une plaine, d’une forêt, d’une chaumière à toit festonné de végétation, ne paraissait pas digne d’occuper l’œil et le pinceau.
Il a fallu la sourde infiltration des idées panthéistes qui donnent de l’importance à toutes choses et animent le brin d’herbe de la même vie divine que l’homme, pour faire qu’on s’attachât à ces formes silencieuses et tranquilles, et que l’on aimât la nature pour elle-même, sans idéal sans composition, sans drame introduit.
Le précurseur, le Saint-Jean de cette jeune école, qui ne doit rien à l’antiquité et compte déjà tant d’illustration, a été Flers, le maître de Cabat. Le premier il a rompu franchement avec le paysage historique ; il a cru qu’une belle forêt pouvait se passer de Céphale et Procris, et qu’un Ulysse tout nu n’était pas indispensable dans les roseaux. On avait bien essayé de faire quelques arbres, quelques montagnes, quelques prairies, mais on excusait les choses par un prétexte mythologique, et le chêne de Fontainebleau était transplanté dans le bois des Euménides ou dans la forêt de Dodone. Flers osa faire des arbres qui n’avaient aucune autre occupation que de porter des branches et des feuilles ; il peignit des pommiers, des saules, des haies d’aubépine, des mares entourées de joncs, des prairies avec des vaches qui n’étaient pas la vache Io ; il crut que l’air, l’eau, le feuillage, l’ombre et la lumière, étaient des sujets bien suffisants. […] (La Presse, 11 août 1849)
D’après Gautier, c’est au moment ou l’homme s’intéresse à la nature elle-même et à la puissance qu’elle porte en elle-même que le paysage est susceptible de devenir un objet de représentation. Le critique envisage le paganisme comme une époque où la nature n’avait pas encore de statut autonome puisqu’elle était porteuse de croyances. Cette absence de prise en compte du paysage pour lui-même implique chez les anciens une absence de représentation du paysage. Ce dernier sera simplement évoqué en lien aux croyances, fonctionnant autours d’un système symbolique. Il accuse le christianisme du même tort de ne voir dans la nature qu’autre chose qu’elle-même, en plus d’y avoir placé une connotation diabolique. Le panthéisme, quant à lui, induit une vision « cosmologique » des éléments qui appartiennent à un « ordre des choses ». Le peintre n’a plus à imposer des codes extérieurs à la nature pour la régir, mais il choisit d’observer l’ordre même de cette nature pour le restituer par la peinture.
On reconnaît ici la préoccupation majeure de Gautier qui revendique une autonomie de l’art : le paysage crée l’opportunité d’une expression nouvelle, entièrement détachée des préoccupations morales, politiques ou historiques et dans lequel seuls le Beau et la Vérité importent. Ainsi dans un certain nombre de ses considérations sur le paysage en peinture il défend cette autonomie de la représentation de la nature :
Dès 1837 dans La Presse :
[…] voilà qui montre bien aux amateurs de sujets ce que peut faire la peinture avec ses propres ressources et quand on ne cherche pas à lui faire exprimer des idées en dehors de ses moyens. Cabat est peut-être un des peintres modernes qui ont le mieux démontré l’inutilité et l’insignifiance du sujet […] (La Presse, 24 mars 1837)
Gautier remet également en cause l’idée de la peinture comme lieu narratif, fictionnel et se détache du principe de « l’ut pictura poesis ». La peinture dispose de ses propres moyens et ne doit pas tendre au même but que la littérature. Cette idée est réitérée par Gautier dans L’Histoire du Romantisme à propos de Théodore Rousseau :
Les tableaux d’un paysagiste n’ont pas, comme ceux d’un peintre d’histoire, de nom qui les distingue.]Il n’y a ni fait ni anecdote dans le paysage tel que le concevait [Théodore] Rousseau. Les personnages n’y interviennent que comme d’agréables tâches de couleurs […] (Histoire du Romantisme, Ed. Ressouvenances, p. 204)
- II. Peintres de style, peintres « naturels ».
Dans les années 1830, à l’époque où Théophile Gautier débute son travail de critique dans La Presse, une nouvelle école se forme en réaction au néo-classicisme, jusque-là dominant. D’une nature idéalisée, souvent récréée en atelier, inspirée de Poussin, de nombreux peintres vont se tourner vers une approche réaliste, favorisée par le développement des pratiques de « plein-air » avec l’école de Barbizon notamment, et influencée par l’école britannique de Gainsborough, Constable ou encore Turner.
La richesse de la critique d’art de Gautier concernant le paysage provient du fait qu’il a su voir, apprécier et mesurer toutes les évolutions qu’a connues ce genre. Il sera un des premiers à saluer les efforts des tentatives naturalistes tout en restant le plus souvent fidèle à l’école néo-classique. Il devient le défenseur acharné, souvent isolé, de peintres aussi divers que Caruelle d’Aligny, Camille Corot et Théodore Rousseau.
Le 17 avril 1845, Gautier propose une analyse comparée des deux écoles de paysagistes :
Deux écoles tranchées se partagent le domaine du paysage : l’une qui recherche le dessin, le style et se rattache au paysage historique, et composée tel que Poussin l’entendait et que l’on pourrait appeler l’école idéaliste ; – l’autre qui s’attache à la réalité, copie la nature d’aussi près que possible et ne croit pas utile d’orner les forêts de nymphes et d’égipans.
La première fait un choix dans ses arbres, dans ses rochers, aime à clore ses horizons par les frontons triangulaires et les tours carrées des villes grecques ou romaines et se soucie assez peu de la vérité pourvu que les lignes soient majestueuses et que l’aspect général ait de la grandeur ; la seconde se contente des champs, des bois et des prairies comme Dieu les a faits ; elle préfère la chaumière couverte de mousse et de giroflées sauvages, dont la cheminé darde sa spirale de fumée bleue à travers le feuillage, aux temples d’ordre dorique ou corinthien assis sur des montagnes impossibles. Elle trouve qu’un ruisseau, pour être intéressant n’a pas besoin de sortir de l’urne d’une naïade, et s’accommode mieux de belles vaches rousses ou tachetées nageant à plein poitrail dans des vagues d’herbe fleurie, que la génisse Io gardée par Argus aux cent yeux.
Nous comprenons ces systèmes si différents et pourtant si justes tous les deux. L’art peut être considéré de deux façons. -La peinture a un but double : de représenter ce qui est et de faire pressentir ce qu’on voudrait qui soit.- Le portrait et le rêve sont également de son ressort. La réalité et l’idéal voilà les grandes, les seules divisions de l’art. Aligny cherche la beauté d’un chêne vert ou d’un laurier rose comme un statuaire grec le profile d’une déesse. – Ce pauvre de La Berge, qui est mort à la peine, copiait les rugosités des branches avec une exactitude qui laisse le daguerréotype bien derrière elle. Tandis qu’Aligny donnait à des troncs d’arbre l’élégance des sculptures antiques : il s’établissait dans une hutte de paille et faisait quatre-vingt cartons pour un brin d’herbe ou un pied de bardane. Nous avons choisi ses noms pour mieux faire sentir notre pensée. –Le premier de ces artistes ne prend de la nature que ce qu’il en faut pour habiller son rêve ; le second, dans son fétichisme de la réalité, use sa vie à compter les nervures des feuilles et les fissures du bois. –Tout deux sont grands.- Entre ces deux extrémités de l’art, il y a des champs infinis. L’idéal se combine avec la réalité de mille manières, et à mille degrés. –Nous croyons cependant que la recherche du style en paysage est souvent dangereuse et nous mène quelques fois à des Calypso ne pouvant se consoler du départ d’Ulysse, qui rappelle les papiers peints des salles à manger de province. Le devant de cheminés dans le goût de l’empire est l’écueil des Aligny, des Corot et des Bertin maladroits.
En suivant la nature on court moins le risque de s’égarer, -un pommier est moins trompeur qu’un système, – et pour dire notre pensée, l’idéal nous semble devoir être plutôt appliqué à la nature humaine qu’à la végétation. On a pu rêver des types plus purs, plus parfaits que ceux qui existent ; le besoin de rendre certaines pensées a dû nécessairement faire chercher des traits particuliers, mais des arbres nous paraissent avoir toute la beauté dont ils sont susceptibles. Il ne s’agit que du choix : il y a peu de femmes à comparer aux madones de Raphaël ; mais nous croyons que les forêts sont pleines de chênes supérieurs aux arbres historiques de Poussin.
Les deux écoles ont d’ailleurs aujourd’hui des représentants d’un grand mérite ; -chaque système se défend par des œuvres excellentes à divers titres, et l’on peut dire hardiment dès aujourd’hui que les paysagistes français n’ont pas de rivaux sérieux à redouter dans aucun temps ni aucun pays. –Ce retour vers la nature est le signe d’une civilisation avancée et qui s’ennuie d’elle-même. –L’homme est si occupé de sa propre existence dans les sociétés primitives, qu’il lui faut deux ou trois mille ans pour s’apercevoir qu’il a un ciel sur la tête et qu’il est entouré de forêts, de plaines et de montagnes. La nature a été inventée quelque temps avant la Révolution Française par Jean-Jacques Rousseau. Jusque là qui s’était inquiété de la pervenche ?
Théophile Gautier distingue deux types de « paysages » en peinture : les paysages « idéalistes », dits aussi paysages « de style » et les paysages « naturels ». Deux critères fondent cette distinction : le rapport au réel et le rapport au dessin.
Les peintres idéalistes se réclameraient de Poussin dans leur volonté de peindre un paysage plus proche du paysage « historique », marqué par un « aspect général de grandeur » et d’Ingres dans leur recherche de du style et de la prédominance du dessin sur la couleur. Gautier intègre des peintres comme Caruelle d’Aligny, Bertin, parfois Corot dans cette école.
Les peintres « naturalistes » comme Théodore Rousseau, Charles-François Daubigny ou Louis Cabat, quant à eux, « copi[ent] la nature d’aussi près que possible et ne croi[ent] pas utile d’orner les forêts de nymphes et d’égipans ». Ils privilégient la couleur au dessin.
Ce système établi n’a pas pour simple but de classer les œuvres selon un ordre de valeur mais de permettre de juger une œuvre à la lumière de ses propres codes. D’ailleurs, Gautier a lui-même revendiqué sa volonté de regarder les œuvres « à travers un prisme » (L’artiste, 14 décembre 1856) particulier et donc d’adopter des critères adéquats à chaque genre. Gautier défend les peintres indépendamment du courant artistique auquel ils appartiennent, pour lui un grand peintre est avant tout un peintre qui suit son idéal, son « système », quitte à être désapprouvé par le public.
La distinction entre les deux genres est cependant toujours en lien avec la question de la « modernité ». Gautier a souvent été présenté comme un partisan d’une certaine tradition en peinture. Pourtant, dans le cas du paysage Gautier prouve, s’il en avait besoin, qu’il n’est pas réticent face à la nouvelle école du paysage français dont il accueille la modernité, le plus souvent, avec enthousiasme.
Admiratif d’une école de paysagistes pouvant être appelée « néo-classique », Gautier fait l’éloge des peintres Théodore Caruelle d’Aligny ou Jean-Victor Bertin. L’éloge de ce courant passe par une comparaison avec le maître du genre, Ingres :
M. Ingres, bien qu’il n’ait jamais fait, que nous sachions, un arbre de sa vie a cependant eu une grande influence parmi les paysagistes. –Imbus de ses principes, de jeunes peintres ont cherché à donner du style à une branche, à un tronc ; ils ont élagué les détails, simplifié les localités de tons, traité les feuilles par masse, renoncé à tout artifice de touche. […]Du premier coup d’œil rien ne semble plus défavorable au paysage qui vit d’ombre, de fraicheur et de transparence, que ce régime d’anachorète de Thébaïde. Eh bien telle est la force du style, telle est la puissance des lignes que, suivant cette route âpre et pierreuse, plusieurs artistes ont produit des tableaux remarquables d’une grande nouveauté. (La Presse, 30 mars 1844.)
Cependant, s’il apprécie les « lignes majestueuses » et la « grandeur » des paysages « de style » (La Presse, 17 Avril 1845), Gautier met en garde le peintre quant à une idéalisation excessive qui peut tourner au ridicule. Pour Gautier, le paysage n’a pas vocation à exprimer des idées, il n’a donc pas à se parer d’une apparence de perfection. La nature se suffit à elle-même. Ainsi, certaines toiles sont décrites avec une ironie à peine voilée :
M. Français […] sait donner aux arbres un port comme il faut, une tournure fashionable. Ce ne sont pas des arbres du commun, on le sent tout de suite ; ils ne croissent qu’au bord des bassins de marbres et ne versent leur ombre que sur des nymphes ou, tout du moins, des seigneurs ; ils n’ont pas été à la cour car leurs racines les retiennent au sol ; mais la cour est venu leur rendre visite. (La Presse, 30 mars 1844)
Il reprend à nouveau cette ironie, avec plus de bienveillance, à propos du peintre Teytaud :
Nous aimons ces compositions élégantes où l’arbre est associé à l’homme comme un compagnon intelligent, et se plie, quelque soit son essence, à l’expression gaie ou triste du sujet, inclinant et relevant à propos ses branches […] selon qu’il faut chanter la victoire de Damaetas ou pleurer la mort de Daphnis. Nous ne haïssons pas que de braves chênes, d’honnêtes lauriers et de candides saules aient lu Théocrite ou Virgile, pourvu toutefois qu’ils ne tombent pas dans la pédanterie […] (La Presse, 17 avril 1845)
C’est donc rapidement vers les peintres « naturels », adeptes du « plein air » que Gautier finit par se tourner. Tout d’abord pour la raison déjà évoqué de autonomie de cet art : rien importe d’autre que la Vérité et la Beauté dans un paysage. Les paysages « naturels » sont par ailleurs appréciés par un Théophile Gautier amateur d’une peinture riche, dense, dominée par la matière, la lumière et la couleur. Citons deux exemples représentatifs de ses qualités essentielles :
A propos de Narcisse Diaz :
Ce sont, comme toujours, des prismes, des queues de paon, des arcs-en-ciel à faire cligner l’œil ébloui ; un papillotage étincelant, un tourbillon de fanfreluches lumineuses, d’atomes dorés, un fourmillement de kaléidoscope, un fouillis de paillons, de pierres précieuses, de soie floche et de chenilles effrangées. (La Presse, 3 Avril 1846)
A propos de L’Allée de Châtaigniers de Théodore Rousseau :
Les admirateurs de Bidault, de Bertin, de Michallon, de Watelet poussèrent des cris aigus à l’aspect de ces arbres monstrueux plantés les uns à côtés des autres, entortillant, avec des nœuds de serpents boa, leurs branches rugueuses à travers une inextricable luxuriance de feuillages, absolument comme cela se passe dans la nature, sans le moindre temple grec au fond, sans le moindre personnage mythologique au premier plan. Ils ne comprenaient rien à cette abondance de sève, à cette multiplicité de détails, à cette richesse inouïe de couleurs, à cette lumière verte que la voute de feuilles tamise sur le chemin. Cette peinture leur semblait le comble de la démence. En effet, si Rousseau avait raison, ils avaient tort ; mais c’était le fou qui était le sage : le temps l’a bien fait voir ! (La Gazette des Beaux Arts, 10 février 1860)
- III. Les prémices de l’impressionisme.
Cette fascination de Gautier envers une peinture « luxuriante », « abondante » et « rugueuse », permet en partie de comprendre son désintérêt pour le courant impressionniste à naître. En effet, alors que l’école de Barbizon développait un style très épais, très dense et très détaillé, Gautier perçoit dans l’évolution de la peinture paysage une tendance « vaporeuse » et « relâchée». Il écrit ainsi en 1868 :
La tache et l’impression, grands mots utilisés aujourd’hui et qui doivent fermer le bec à toute critique, ne suffisent pas. Nous ne voulons pas de la peinture léchée mais il nous faut de la peinture faite. (Le Moniteur Universel, 11 mai 1868.)
Ainsi, il observe avec regret l’évolution de peintres qu’il appréciait énormément comme Daubigny et surtout Camille Corot :
A propos de Daubigny :
Il est vraiment dommage que M. Daubigny, ce paysagiste d’un sentiment pourtant si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une première impression et néglige à ce point les détails. Ses tableaux ne sont plus que des ébauches ; et des ébauches peu avancées. Ce n’est pas le temps qui lui a manqué […] ; c’est donc à un système qu’on doit attribuer cette manière lâchée que nous croyons dangereuse pour l’avenir du peintre s’il ne l’abandonne au plus vite. Nous n’aimons pas plus qu’un autre le fini minutieux, admiration et joie des philistins, et nous admettons que l’artiste procède par masses. Ce n’est pas des Delaberge que nous demandons à M. Daubigny. Nous n’exigeons pas de lui les nervures d’une feuilles au troisième plan ; mais encore faut-il que les arbres s’agrafent au sol par des racines, que leurs branches s’insèrent à un tronc et qu’ils tracent sur le ciel une silhouette distincte, surtout lorsqu’ils occupent le premier plan. Les arbres ne sont ni des plumets ni des fumées. […] Chaque objet se dessine par un contour apparent ou réel, et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des tâches de couleurs juxtaposées. (Le Moniteur Universel, 7 juin 1861)
A propos de Camille Corot :
A force de bercer dans ce rêve charmant qu’il fait les yeux ouverts, M. Corot finit par ne plus voir la nature qu’à travers une vapeur idéal. Il semble qu’une gaze d’argent s’interpose entre lui et les objets. Tout s’adoucit tout s’estompe, tout se décolore harmonieusement. On dirait, en voyant ses tableaux, ces paysages élyséens que décrivent les poètes, et où les ombres heureuses se promènent nonchalamment dans les prairies d’asphodèles, sous des arbres d’un vert grisâtre, à la lueur d’un jour pâle, qui ne vient pas du soleil, et qui ressemble à un clair de lune diurne. Nous comprenons tout le charme de cette manière, et nous avons loué bien des fois M. Corot comme il le mérite. […] Il ne tient qu’à lui de déchirer cette brume d’un rayon de soleil. Nous avons vu dans son atelier des études d’une force de ton, d’une netteté de contour et d’une puissance de rendu incroyables : des vues prises sur les lagunes étincelaient de lumières ; des chênes verts découpaient leur ombre bleue sur des ocres fauves avec une vigueur féroce, des rochers semblaient défier le marteau du minéralogiste. Cet affaiblissement vaporeux tient à un système et non à une défaillance. Que M. Corot, au lieu de rêver la nature, la regarde bien en face, et il verra le succès qu’il obtiendra au Salon prochain (Le moniteur Universel, 29 juillet 1866)
Cette critique envers Camille Corot ne doit pas faire oublier que cet artiste paysagiste fut l’un des plus célébrés par Théophile Gautier.
- IV. Camille Corot
Camille Corot (1796 – 1875) semble échapper à la classification décrite et analysée auparavant, car il est à la fois un « idéaliste » et un maître du « Plein Air ». Ce statut quelque peu à part fera de lui l’un des artistes les plus appréciés de Gautier, bien avant que le grand public ne le reconnaisse à sa juste valeur. Pour le critique, Camille Corot a su allier des éléments contradictoires à la tradition classique du paysage : les motifs antiques sont peints avec « fraicheur », « originalité » et « naïveté ». Pour définir ce genre pictural singulier, Gautier choisit de comparer les paysage de Corot à des Idylles antiques, qui tiennent plus de la rêverie poétique que de la représentation héroïque et flamboyante d’un passé mythologique.
La Presse, le 17 avril 1845 :
M. Corot a trois morceaux moitié antiques moitié naturels. Par un rare privilège, M. Corot apporte dans un genre de convention une naïveté presque enfantine. Les sujets les plus classiques, traités par lui prennent une teinte de bonhomie ; il entend le grec un peu à la façon de La Fontaine dans sa Psyché et ses imitations libres d’Anacréon. Un trait aimable vient tempérer l’ennui tout à propos. –L’exécution consciencieuse mais incertaine de M. Corot empêche ses paysages de tomber dans la sécheresse. On pourrait désirer des branches plus nettes, un feuillé mieux écrit, des roches aux arrêtes plus franches ; mais du vague même de la touche, de la maladresse du pinceau résulte une douceur, une tranquillité d’effet qu’une exécution plus habile détériorerait peut-être. Chez quelques peintres trop adroits, le pinceau devance trop souvent la pensée ; avant qu’il y songe, l’objet qu’ils veulent peindre se trouve achevé comme malgré eux. M. Corot, à travers ses tâtonnements et ses bavochages, arrive à l’effet général, qu’il ne perd jamais de vue ; quoique son dessin manque de précision et sa couleur soit quelquefois grise et plâtreuse, il fait des choses pleines de charme et de fraîcheur. –Les bonshommes qu’il asesoit ou qu’il couche dans ses herbes ou sous ses ombrages, bien que d’une anatomie fort négligée, sont fait avec une telle candeur et un si fin sentiment poétique, que l’on serait fâché de les voir touchés par une main plus belle.
La Presse, Le 6 juin 1852 :
Ce qui fait le charme de Corot c’est une maladresse enfantine, une bonhommie adorable à laquelle on se laisse aller sans crainte de déception. La couleur générale a beau être grise, sourde et monotone, le dessin bavoché, la touche gauche et pâteuse, une grâce mystérieuse, une fraîcheur toujours jeune, une séduction invisible rachètent tous ces défauts. On aime encore plus Corot que l’on ne l’admire, il a ce qui manque à de plus brillants, à de plus habiles, une sincère passion de la nature. Panthéiste plutôt que réaliste, il a voué un culte secret aux dieux sylvains et aux nymphes bocagères.
Il ne pénètre dans les bois qu’agité d’une espèce de frisson religieux ; ses premiers plans auront beau être incertains, obscurs et manqués, soyez sûrs qu’un ciel tendre, vaporeux, léger, d’une lueur douce et crépusculaire baignera le haut de la toile et qu’une âme pénétrera comme un souffle ou un reflet dans ces arbres, ces rochers et ces eaux. Corot est le Proudhon du paysage, un poète d’églogue antique, argenté de clairs de Lune, tempéré de mélancolie moderne. Ses tableaux sont plus comme l’expression d’un désir que celle de la réalité ; avant de les avoir vus on les avait rêvés longtemps et ils fournissaient des sites tout prêts à quelque amour timide, à quelque tristesse inavouée, à quelques mélancolies dont on ignore la cause ; son Soleil couchant et son Repos rentrent tout à fait dans la nature d’idées que nous venons d’exprimer ; mais la Vue du port de la Rochelle appartient à un tout autre ordre d’impressions. – Ce ciel blanc, ces eaux grises, ces longs quais blafards ont un aspect de vérité étrange, et montrent que M. Corot sait copier juste la nature lorsqu’il ne veut pas la poétiser.
Malgré la présence récurrente de motifs antiques dans la peinture de Corot, Gautier ne cesse d’évoquer la « modernité » et « l’originalité » de ce dernier. En observant chez lui un véritable amour de la nature pour elle-même associé à une poésie idyllique, Gautier décèle chez Corot l’opportunité d’échapper aux écueils aussi bien des idéalistes que des « naturalistes ». D’une part, il ne s’agit plus de peindre les mythes antiques mais d’en évoquer délicatement le souvenir qui naît au contact de la nature. D’autre part, peindre la vérité de la nature, ne veut pas dire s’enfermer dans un réalisme terre à terre. Pour Gautier, c’est au contact de la nature que surgissent chez Corot les idées de magie, de mystère, de spiritualité et de poésie.
****
Au-delà de toutes les tensions qui se jouent quant au potentiel conflit entre modernité, romantisme et classicisme, certains aspects demeurent centraux dans la conception du paysage chez Théophile Gautier.
Ce dernier est un chantre de la forme et de la matière. La critique littéraire a souvent souligné sa préférence pour l’expression du sensible plutôt que celle d’un moi intime et lyrique. Son attachement à une conception autonome de l’art en est aussi le reflet : la forme est essentielle, non pas au mépris de l’idée mais préalable à l’idée, principalement en peinture.
Ses écrits sur le paysage en peinture sont tout à fait représentatifs de cet aspect de son esthétique. Le Gautier qui se dévoile au travers de sa critique est un Gautier principalement touché par une nature saisie objectivement dans sa puissance, dans sa richesse de formes, de coloris, de mouvements. Ainsi, il reçoit souvent avec enthousiasme les œuvres de l’école naturaliste. C’est notamment en observant la certaine réticence avec laquelle il accueille les prémices de l’impressionnisme, que l’ont peut saisir cette volonté d’une peinture, d’un art attaché à la matière, à la forme, au sensible et non pas à l’impression, à l’émotion. Celles-ci sont fuyantes et incertaines, contrairement au réel et à la perception dont Gautier ne « doute » pas. Il s’agit de rendre tangible la beauté afin d’en mettre à jour le mystère. La réalité, chez Gautier peut être représentée au plus proche parce qu’elle n’est pas close : elle évoque, elle inspire elle est propice au surgissement du surnaturel, du « bizarre » et du beau.
Bibliographie :
GAUTIER, Théophile, Histoire du romantisme, Coeuvre et Valsery, éditions Ressouvenances, 2007.
LACOSTE-VEYSSEYRE, Claudine, LA Critique d’art de Théophile Gautier, Montpellier, Université Paul Valéry, 1985.
GIRARD Marie-Hélène, Théophile Gautier, Critique d’art : extraits des salons, Paris, Séguier, 1994.
Liens vers le site Gallica.fr :
Pour les articles de La Presse :
24 mars 1837 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426976d
30 mars 1844 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4295357.image.f1.langFR
17 avril 1845 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4299131.image.f1.langFR
3avril 1846 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k430261k.image.f1.langFR
11 août 1849 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431449t
6 juin 1852 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k475893k4
Pour l’article de La Gazette des beaux Arts :
10 février 1860 :
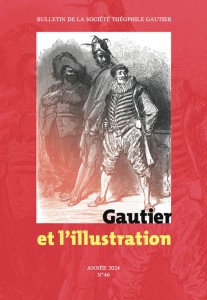
 Envoyer cette page à un ami.
Envoyer cette page à un ami.
